
BOURGOGNE
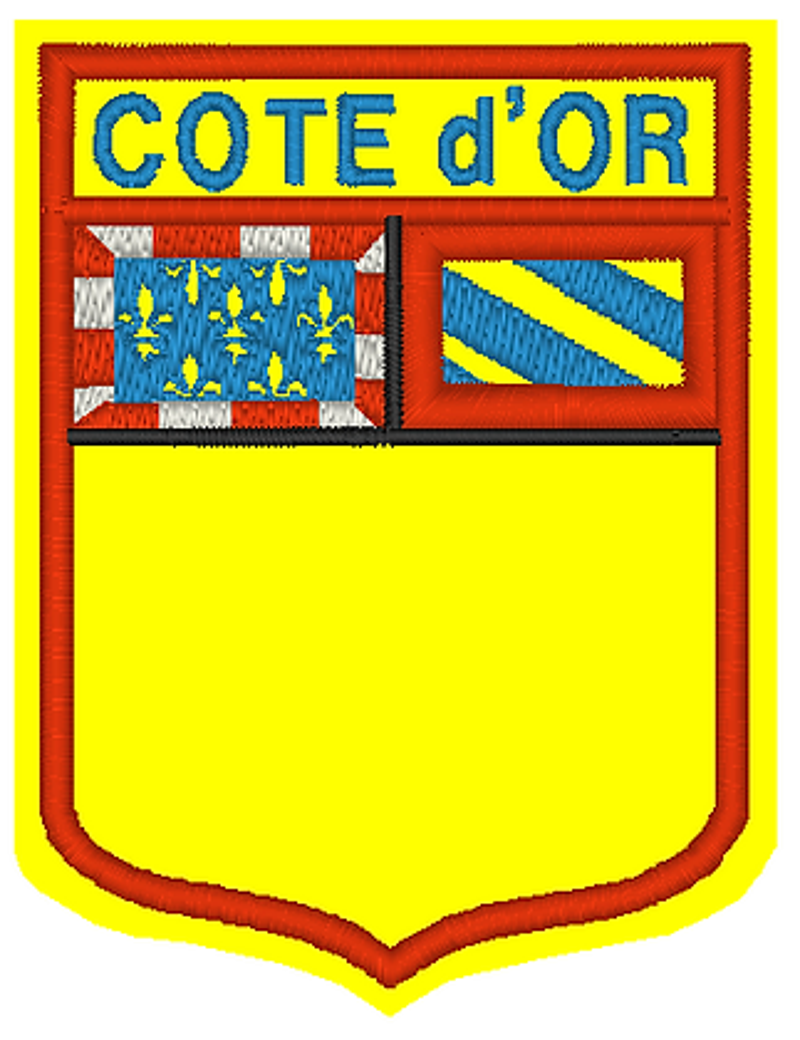




Le Creux du Diable
C’est un jour de Pâques ! le carillon chante l’Alléluia dans le beffroi, l’alouette le redit, dans les blés, le merle le siffle dans les bois, et le soleil l’écrit en lettres d’or sur le ciel bleu. Tout dans la nature semble avoir pris un air de fête pour célébrer la résurrection du Christ.
Dans le village de Lux (21), les cœurs répondent à cet Alléluia, et le bon peuple prend ses habits de fête, pour aller entendre matines et recevoir la communion. En ce jour, Jésus, le Soleil de justice, vient rajeunir les âmes et répondre sur elles un céleste printemps.
Gaston, le seigneur du village, ne comprend rien aux joies pures et intimes que ramène la Pâque chrétienne. C’est un jeune baron, fier, hautain, violent et passionné pour la chasse. Il sonne du cor et crie à ses gens : « Sellez les chevaux et amenez ma meute. »
En vain les piqueurs et les varlets lui représentent la solennité du jour et le commandement du Seigneur. « Partons pour la chasse, leur répond-il ; laissons aux femmes et aux prêtres le soin de prier Dieu. Il serait dommage de perdre si magnifique journée. »
Les chevaux sont prêts, et les chiens aboient dans la cour du castel. Au moment où Gaston donne le signal du départ, le vieux chapelain accourt, et saisit le frein de son coursier. « De grâce, Monseigneur, s’écrie-t-il, ne faites pas à Dieu pareil outrage, n’imprimez pas à votre âme semblable souillure. »
Le violent baron soufflette le vieux prêtre.
Celui-ci, tendant le visage, dit avec calme : « Monseigneur, frappez encore ; mais de grâce, pour votre âme, ne manquez pas aujourd’hui le service divin. Si vous le faites, il vous arrivera malheur. »
Il repousse brusquement le vieillard, et s’éloigne.
Gaston, suivi de sa meute et de ses gens, traverse la bourgade en sonnant du cor à pleins poumons. Il jette un regard de dédain sur les bons villageois qui le saluent et se rendent à l’église. « Il arrivera malheur à notre sire, murmurent les vieillards ; il est haut et puissant seigneur, mais il insulte et brave plus haut et plus puissant que lui. »
Deux grands chemins se croisent à l’entrée de la forêt de Velours. Là deux cavaliers, plus rapides que le vent, arrivant, et se placent aux côtés de Gaston.
Celui de droite, monté sur un cheval blanc, a noble et radieux visage ; un regard céleste brille sous sa paupière, et ses vêtements, qui ont l’éclat de la neige, répandent un parfum plus suave que celui de la campagne dans un jour de printemps.
Celui de gauche a la figure farouche : son regard lance de sinistres éclairs ; il a le teint basané ; sa chevelure est plus noire que l’aile du corbeau ; ses vêtements, plus sombres que la nuit, exhalent une forte odeur de soufre ; son coursier est couleur de feu.
« Amis, s’écrie Gaston, soyez les bienvenus ! Vous arrivez fort à propos pour courir avec moi à travers les grands bois. Quelle heureuse journée ! Il n’y a pas au ciel et sur la terre d’amusement comparable à la chasse, surtout quand on est plusieurs.
— Jeune seigneur, dit le cavalier de droite, la cloche vous appelle ; entendez sa voix plaintive qui vous poursuit à travers les arbres. Retournez ; il vous arrivera malheur. Allons nous agenouiller ensemble à l’autel du Christ. Déjà, avant l’aurore, j’ai ouï la messe et chanté l’Alléluia ; je le ferai encore volontiers avec vous. Allons, le devoir accompli, le plaisir de la chasse sera plus doux.
— Chassez, chasses, noble baron, reprend le cavalier noir ; n’écoutez point cet importun conseiller. Les fanfares du cor sont plus harmonieuses que le son des cloches, et la chasse vous amusera plus que les sermons des prêtres et les chants d’Église.
— Bien dit, homme de la gauche, s’écrie Gaston. N’en déplaise à ce cavalier blanc, tu es un gai compagnon comme je les aime. À nous autres jeunes seigneurs il faut de joyeux propos et de bruyants ébats ; laissons aux moines leurs sermons et leurs patenôtres. »
Tous trois s’enfoncent dans la forêt.
Gaston fait détacher ses chiens. Il les caresse du regard, les flatte de la main, les excite de la voix, et les lance à la poursuite du gibier. Ceux-ci flairent le sol. La tête basse, la queue frétillante, ils parcourent la forêt.
Ils donnent de la voix ; ils sont sur la piste de la bête fauve. Leurs cris redoublent ; ils approchent de son gîte. Ils se glissent dans un épais fourré ; ils jettent des hurlements furieux ; ils ont découvert un loup de forte taille.
Le féroce animal se dresse : le poil hérissé, l’œil en feu, la gueule menaçante, il essaie d’abord de tenir tête aux limiers. Puis il fuit à travers le grand bois. Il court, cherchant les taillis les plus épais, les gîtes les plus secrets. C’est en vain, la meute ardente est toujours attachée à ses pas.
Il gagne la campagne. La chasse le suit : Gaston a sonné du cor et a réuni ses gens. On galope à travers les blés et les buissons, les landes et les prairies.
Le baron arrive près d’un hameau, d’où sort une petite bergère à la tête de ses brebis. Là le chemin est étroit et bordé de haies. L’enfant, tout en pleurs, s’écrie : « Pitié ! doux seigneur ; pitié ! épargnez mon troupeau ; de grâce, n’écrasez point les brebis de la veuve et les agneaux du pauvre.
— Pitié, au nom de votre âme, dit à son tour le cavalier blanc ; ne méprisez pas ces prières et ces larmes ; elles monteraient vers Dieu et crieraient vengeance contre vous.
— Écrasez agneaux et brebis, répond le cavalier noir, cela ne doit point troubler le plaisir d’un jeune seigneur. Faut-il pour si peu laisser échapper la bête fauve !
— Tu as raison, » s’écrie le farouche chasseur. Il lance son coursier, et entraîne après lui ses piqueurs et ses varlets. Seul, le blanc cavalier se détourne et gémit.
La chasse a passé comme un ouragan, laissant après elle la désolation et la mort : des brebis sont tombées sanglantes, des agneaux sont écrasés, et la petite bergère gît sur le sol, broyée comme une fleur des champs.
Le loup luit toujours. Il franchit les champs et les bois, les collines et les vallées, les coteaux et les montagnes. Rien ne peut l’atteindre. Les limiers tombent de lassitude, et les montures ont peine à porter leurs cavaliers.
La chasse arrive dans un val solitaire. Là, près d’une fontaine qui jaillit sous un vieux chêne, s’élèvent une petite chapelle et une chaumière entourées d’un champ de blé vert. C’est le domaine d’un vieil ermite, dont les jours s’écoulent dans la travail et la prière. Cet anachorète est l’hôtelier du pauvre et le guide du voyageur.
« Noble baron, si vous voulez m’en croire, dit le noir cavalier, nous prendrons ici notre repas ; voici de l’eau pour notre soif et un gras pâturage pour nos coursiers.
— Ma foi ! s’écrie le chasseur, tu as là une merveilleuse idée. » Gaston sonne du cor, et réunit sa meute et ses gens. Et, malgré les prières du blanc cavalier et les répugnances des varlets, il fait mettre ses chevaux dans Ie champ de blé vert.
L’ermite accourt, et dit du ton le plus suppliant : « Pitié ! gracieux seigneur ; épargnez les sueurs d’un vieillard ; ne faites pas dévorer et fouler aux pieds par vos montures le champ qui nourrit le pauvre et le voyageur.
— Au diable les ermites et les nonnains ! répond l’orgueilleux chasseur. Retire-toi, être vil et paresseux, si tu ne veux pas servir de pâture à mes chiens. »
Le vieillard s’éloigne, triste et épouvanté, murmurant tout bas : m Père, qui êtes dans les cieux, pardonnez à ce jeune homme : votre providence, qui nourrit les oiseaux du ciel et revêt les fleurs des champs, me suffit.
— Gaston, reprend le blanc cavalier, votre langage est bien dur. Eh ! qui sait si vous ne devez pas à cet homme de vivre encore à cette heure. Déjà, peut-être, votre âme a été pesée plusieurs fois dans la balance de la justice divine, et sans les jeûnes, les veilles et les prières de celui que vous accablez de votre insolent mépris, elle aurait été trouvée trop légère. »
Assis près de la fontaine de l’ermitage, les chasseurs font long et gai repas. Malgré les avis du blanc cavalier, les propos sont impies et licencieux. Le jeune baron méprise les sages conseils de celui qui est à sa droite, et applaudit avec un fou rire aux discours de l’homme noir.
C’est l’heure des vêpres, l’ermite sonne la cloche de la chapelle. Ce jour-là il ne fut pas seul dans le sanctuaire ; le blanc cavalier laissa ses compagnons, et redit avec lui les psaumes et les cantiques. Jamais le solitaire n’entendit voix plus pure et n’eut entretien plus céleste.
Les deux serviteurs de Dieu, sortis ensemble de la chapelle, s’arrêtent un instant sur le seuil. Ils regardent. Les chasseurs ont disparu. Le champ de blé vert est ravagé et meurtri comme si la grêle l’eût frappé ; les chevaux de Gaston ont détruit en moins d’une heure le travail d’une année.
Le blanc cavalier embrasse l’ermite et se hâte de rejoindre le baron. C’est avec peine que le solitaire le voit s’éloigner. Quel est, se dit-il, ce beau chasseur ? son baiser a rempli mon âme de paix et de joie ; et je me sentais tout embrasé par sa présence.
Les chiens ont relancé la bête fauve. Le loup revient sur ses pas ; il traverse les monts et les coteaux, les vallées et les collines, les bois, les champs et les prairies.
L’ombre des arbres s’allonge ; le soleil est descendu à l’horizon. La chasse traverse une seconde fois le hameau. Un pauvre est dans le chemin encore rougi du sang de la bergère ; il attend Gaston, il saisit son manteau et demande l’aumône pour l’amour de Dieu.
« Cher baron, s’écrie le blanc cavalier, c’est un moyen de salut que le Seigneur vous envoie. De grâce, rachetez vos péchés par l’aumône ; elle est comme l’eau qui éteint le feu. Assistez le représentant de Jésus.
— Gaston, crie à son tour le cavalier noir, allez-vous pour ce manant ralentir votre course et perdre l’occasion de frapper la bête fauve ? Galopons ! galopons !
— Voilà mon aumône ! » dit le féroce seigneur, en faisant bondir son cheval et en lançant un coup de fouet au visage du pauvre.
Le mendiant jette un cri et essuie sa face sanglante.
Le loup et la chasse rentrent dans la forêt de Velours. L’animal est infatigable ; il brave chiens et piqueurs, coursiers, seigneurs et varlets.
Le soleil s’est couché derrière les grands arbres. Les ténèbres de la nuit se mêlent aux ombres de la forêt. C’est l’heure favorable aux sérieuses pensées.
« Ami, dit à Gaston le blanc cavalier, la journée a été mauvaise : vous avez méprisé Dieu, souffleté son ministre, écrasé la bergère et son troupeau ; vous avez ravagé le champ de l’ermite et frappé le visage du pauvre. Croyez-moi, jetez un regard suppliant vers le ciel, et poussez un cri de repentir vers Dieu.
— Peccadilles que tout cela, répond en ricanant le chasseur. J’ai le temps de penser à mon âme. Quand je ne pourrai plus courir les grands bois, je veux porter la haire, faire largesse aux moines et aux mendiants, fréquenter les églises et marmotter psaumes et rosaires. Mais, auparavant, je veux user gaiement de la vie.
— Gaston, la vie de l’homme est courte et fragile ; elle lui est donnée non pour être dépensée en folies, mais pour acheter le ciel. Je vous en conjure, au nom de votre âme, criez à Dieu merci !
— Quel ennuyeux compagnon ! qu’il soit en paradis !… » s’écrie le jeune seigneur, irrité à la fois par ces instances et l’insuccès de la journée.
« Adieu ! Gaston, murmure le cavalier blanc. Pourquoi n’avez-vous point écouté celui qui voulait vous sauver ! » En disant ces mots ; il essuie une larme, étend deux ailes blanches et prend son essor vers les cieux, laissant après lui un sillon de lumière.
Le chasseur comprend que son bon ange l’a quitté. Il regarde à sa gauche. Un frisson d’effroi parcourt ses membres, et la sueur de la mort couvre son visage : l’homme noir étend ses bras et le saisit. Il se sent transpercé par des griffes plus acérées que celles du vautour, plus puissantes que celles du lion. Il rugit de douleur et d’épouvante : il est tellement éperdu, qu’il n’a pas même la pensée de crier vers Dieu, de se signer et d’invoquer Jésus.
Le cavalier noir, tenant sa proie, frappe la terre île sa lance. Le sol gémit et s’entrouvre, laissant échapper un immense tourbillon de fumée. Une mer de feu bouillonne au fond d’un gouffre béant, et ses vagues brûlantes roulent d’infernales multitudes, dont on distingue les lamentations, les cris et les blasphèmes. Des flammes vertes, rouges et bleues s’élèvent de l’abîme ; elles s’agitent vengeresses autour du criminel chasseur ; elles se tordent et sifflent comme des serpents de feu.
« Gaston, dit le cavalier noir en lançant son coursier dans le bouillant cratère ; Gaston, tu m’as écouté pendant la vie, tu m’appartiendras durant l’éternité.
— Malheur à moi ! s’écrie le réprouvé, j’ai méconnu le jour du Seigneur et les conseils du bon ange !… »
Et l’abîme se referme, en formant une hideuse et sinistre cavité : c’est le Creux du Diable.
Étienne BAVARD 1880)
Les cheveux conservés
À la campagne de Saône-et-Loire (71), quand une ménagère, fille ou femme, se peigne, elle ne jette point les cheveux qu’elle enlève de sa tête.
J’entrais un jour chez une brave et vieille vigneronne. Je la trouve en train de se peigner et je la vois ramasser avec soin tous les cheveux arrachés par l’opération. Comme elle était très propre, je pensais qu’elle allait les mettre dans un papier pour les brûler. Mais non ; après les avoir roulés autour de son doigt, elle les gardait religieusement dans sa main : – « Eh bien ! Mère Thomas, lui dis-je, vous n’allez point vous débarrasser de çà ? » – « Non par ben, not' moussieu ; j' les ramassons. » – « Et qu’en faites-vous, s’il vous plait ? » – « J' m’en vas les mettre dans la borgnotte. Ils sont là en sûreté, et quand j' ressusciterons, j' serons certaine de les retrouver. »
La borgnotte (ou bornotte) est la cachette toute naturelle du paysan. C’est un des petits interstices qui, çà et là, se rencontrent à l’intérieur des murailles, entre les pierres mal jointes dont elles sont bâties. On y découvrirait aussi bien les piécettes d’argent du vigneron que les cheveux de la vigneronne. – Borgnotte vient de borgne, et veut dire : trou sombre, coin où l’on n’y voit guère. Bornotte n’est qu’une nuance dans la prononciation du mot.
F. FERTIAULT (1886)
L’abbaye de Saint-Marguerite
Jadis vivait au château de Vergy, à Bouilland (21), une jeune damoiselle, belle et pure comme un ange ; elle avait nom Marguerite. Maints jeunes pages désiraient sa main : l’un d’eux était éblouissant de jeunesse et de beauté ; mais son langage était peu pudique, et la perfidie perçait dans son regard et dans son sourire. Aussi Marguerite ne voulait onques ouïr ses profanes discours ; elle le repoussait disant : « Que me parlez-vous d’amour terrestre, à moi qui ai choisi pour l’éternité Jésus, le plus aimable et le plus riche des époux ? »
Le nom de Jésus était un charme divin qui faisait pâlir le beau page et le mettait en fuite. La sainte damoiselle, suivie d’une de ses compagnes, allait quelquefois deviser de Dieu et du ciel avec un vieil ermite qui habitait au sein d’une forêt profonde.
Un soir qu’elle revenait d’un de ces entretiens, et que, montée sur sa mule, elle traversait le grand bois, elle aperçut le page qui l’attendait au détour d’un sentier. Vite, elle tourne bride ; et, dans sa fuite, elle abandonne son voile aux rameaux d’une aubépine. Rapide est la course de sa monture ; mais plus rapide est celle du beau page : il est plus léger que le vent, et sous ses pieds l’herbe ne plie point. Pour comble de malheur, la pauvrette, au lieu de suivre, comme sa compagne, le grand chemin de la vallée, s’engage dans un faux sentier que termine un long rempart de roches.
C’en est fait, elle va devenir la proie du ravisseur !… Déjà, il s’apprête à la saisir, et, jetant ses mains frémissantes sur la jeune fille, il pousse un infernal éclat de rire qui remplit le vallon. Mais, en ce moment, Marguerite se souvient de son Fiancé céleste ; elle l’appelle à son secours, elle murmure son nom et s’arme de son signe. Au nom de Jésus, qu’elle prononce avec cette foi qui remue les montagnes, le rocher s’entrouvre et laisse passer la mule qui emporte la vierge chrétienne.
Et le faux page, qui n’était qu’un démon,
Comme au feu d’un bouillant cratère,
Soudain s’abîme sous la terre,
En laissant tomber de sa main
Une chatte ceinture aux ronces du chemin.
La damoiselle de Vergy arrêta sa course près d’une fontaine, à quelques pas de la Roche-Percée. Elle descendit à terre, et, se prosternant, elle voua au Seigneur sa virginité miraculeusement conservée.
Plus tard, de la dot que lui laissa son père, elle composa, en l’honneur de son Époux céleste, un long cantique d’action de grâces, en élevant dans ce lieu un monastère, auquel elle donna le nom de sainte Marguerite, sa patronne.
Étienne BAVARD (1879)
Les sept brouettées de cierges
Une femme disait un jour en confession :
— Mon père, je m’accuse d’avoir trompé mon mari.
— Et l’avez-vous trompé plus d’une fois, ma fille ?
— Oui, mon père.
— Combien de fois ?
La femme réfléchit quelques instants, puis :
— Je ne pourrais vous le dire en ce moment, j’ai besoin d’y penser.
— Eh bien ! pensez-y cette nuit et, demain matin, vous apporterez à l’église autant de cierges que vous avez commis de fois l’action dont vous vous accusez.
Le lendemain, à l’heure où le curé montait à l’autel pour dire la messe, la femme arriva à la porte de l’église. Elle poussait devant elle une brouette chargée de cierges et, à chaque tour que la roue faisait, cette roue mal graissée criait, criait… si bien que le curé, impatienté d’entendre ce bruit, retourne la tête vers la porte en disant :
— Chut ! chut !
— Il n’y a pas de chut ! chut ! qui tienne, répondit la femme ; j’ai encore à amener sept brouettées comme celle-ci !
Conté par Charles Lesort, né à Saint-Andelai (58) en 1827
Achille MILLIEN (1888)
Thilda
Quand on suit la pittoresque route qui va de Clairmain à Matour (71), on aperçoit à mi-chemin environ, sur les collines de droite, un petit bois de sapins.
Là, il y a une cinquantaine d’années, au milieu de pans de murs et d’escaliers en ruine, une haute croix de pierre à moitié détruite, et dont le socle marque aujourd’hui la place.
Ces ruines et cette croix ont une terrible histoire.
Jadis, il a bien longtemps, bien longtemps, à la place des sapins au tronc droit et régulier comme des fûts de colonne, s’élevait un vaste château aux tours massives et aux poivrières aiguës, dont la masse imposante dominait la vallée.
Or, à l’époque où se passait l’histoire, le vieux baron de Maslefort, propriétaire de ce manoir avait chaque jour à sa table, nombre de seigneurs et de preux chevaliers qui venaient là de tous les pays du monde.
Certes, l’hospitalité du baron était grandiose, et les chasses qu’il donnait étaient émouvantes et magnifiques, mais tout cela ne suffirait pas à vous expliquer une telle affluence de visiteurs, si je ne vous disais de Maslefort renfermait alors la belle Thilda, fille du baron, la merveille du duché de Bourgogne.
Thilda était brune comme la nuit, ses grands yeux profonds et changeants, ses lèvres d’un dessin exquis et pur, ses cheveux dont les boucles soyeuses descendaient librement sur ses épaules, tranchant sur la pâleur d’ivoire des joues, en faisaient une créature étrangement belle et désirable.
Cependant, pas un des hôtes de son père ne pouvait se flatter d’avoir obtenu d’elle le moindre mot d’espoir, elle accueillait les madrigaux les plus galamment tournés et les déclarations les plus brûlantes avec un sourire également moqueur.
Mais le soir, quand tout dormait au château, une voix douce et fière montait de la vallée, chantant une romance de ce temps-là :
Dame dont le sourire
Captive et pauvre cœur,
Qui souffre et n’ose dire
L’excès de sa douleur ;
Ah ! laisse-toi fléchir
Ou me faudra mourir !
La brune Thilda sortait alors du château par une issue secrète, et bientôt se trouvait dans les bras du chanteur qui n’était autre que Francel, le blond ménestrel dont les tensons, les lais et les romances se chantaient dans toute la Bourgogne.
Ils s’aimaient d’un fol amour, et Thilda avait juré à Francel de n’appartenir jamais à un autre homme.
Or, les circonstances impérieuses forcèrent un jour Francel à quitter sa maîtresse pour aller guerroyer au loin.
Deux ans se passèrent sans que Thilda, dont la pâleur avait augmenté encore et dont un cercle de bistre estompait maintenant les yeux, reçut de son bien-aimé la moindre nouvelle.
Cependant son père qui se sentait mourir, la pressait davantage de prendre un mari. Devant les refus obstinés de la pâle enfant, le vieux seigneur se faisait un chagrin mortel.
Trois ans s’étaient écoulées sans nouvelles. Le baron venait de déclarer à sa fille que si elle n’acceptait pas son cousin Hugues pour mari, elle ferait le désespoir de ses derniers jours, et qu’il mourrait en la maudissant. La pauvre Thilda désespérant de jamais revoir son ami, finit par consentir…
Le sire Hugues de Combernon, grand chasseur et formidable buveur dont la barbe rouge effrayait les petits enfants, devint l’heureux époux de la merveille du duché de Bourgogne.
Trois années encore s’écoulèrent. Une nuit, sire Hugues, rentré de la chasse, dormait d’un profond sommeil aux côtés de sa jeune épouse, qui, le regard perdu dans la nuit, songeait.
Soudain, une voix vibrante se fit entendre dans la vallée :
Dame dont le sourire
Captive et pauvre coeur,
Qui souffre et n’ose dire
L’excès de sa douleur…
C’était Francel, Francel qui revenait chevalier et capitaine, demander la main de celle qu’il n’avait jamais oubliée.
Au son de cette voix la pauvre Thilda se mit à trembler qu’elle réveilla son mari.
Francel continua sa chanson :
Ah ! laisse-toi fléchir
Ou me faudra mourir.
— Quel est l’étrange fol qui vient ainsi troubler notre repos ? s’écria le sire Hugues se réveillant tout à fait.
Ah ! laisse-toi fléchir
Ou me faudra mourir.
répétait le blond ménestrel.
— Oh ! oh ! qu’est ceci, gronda Hugues. Par ma foi, madame, je veux voir de près quel est l’audacieux qui vient à cette heure vous dire des chansons d’amour ? Et s’habillant à la hâte, il ceignit son épée et sortit par une poterne basse…
Quelques minutes après, Thilda, de plus en plus tremblante, entendit de terribles blasphèmes, puis deux grands cris qui réveillèrent toute la montagne.
Affolée, la pauvre enfant s’élança à demi-nue par le chemin que son mari devait suivre, en appelant d’une voix déchirante : Francel, Francel !
Mais les orfraies seules répondaient à ses appels par des hululements plaintifs.
À cet instant, la lune émergea, sanglante, au dessus des nuages, et Thilda vit à ses pieds les cadavres de son époux et de son fiancé, enlacés dans une dernière et mortelle étreinte.
La blonde tête de Francel était éclairée en plein par la lune. Ses lèvres crispées, frangées d’une écume de sang, s’entr'ouvaient comme pour maudire ; et son regard fixe semblait reprocher sa trahison à la fiancée parjure.
— Pardon ! pardon ! gémit Thilda.
Et s’agenouillant, elle prit dans ses bras la tête pâle du mort, qu’elle couvrit de baisers passionnés.
Mais les lèvres de Francel conservaient leur malédiction muette, et ses yeux leur reproche effrayant.
Alors, Thilda toute blanche se releva, et tirant le poignard de son amant, se le plongea par deux fois dans la poitrine…
Le lendemain, on releva les trois cadavres. On ne put jamais retirer Francel des bras de Thilda, qui l’étreignait dans un embrassement suprême.
On fit élever, à cet endroit, une haute croix de pierre. C’était celle dont on voit encore aujourd’hui les ruines.
Mais dans toutes les fermes de la montagne, on vous racontera que par les nuits d’automne, on entend une voix plaintive sortir du bois de sapins.
Cette voix gémit : Francel ! Francel !
— C’est Thilda qui vient chercher le pardon de son fiancé ! murmurent en se signant les vieux pâtres.
Charles REMOND (1888)
Le lait de la Vierge
Il existe plusieurs volumes sur les nombreux miracles dont Châtillon (21) fut le théâtre et dont saint Vorle a été le principal acteur au temps du roi Gontran.
Les bourdons de la cathédrale
La sonnerie de l’église cathédrale de Sens (89) a, depuis bien des siècles, acquis une célébrité justement méritée par sa merveilleuse harmonie. Qui n’a pas entendu parler de la cloche Marie, qui, dans une journée pleine d’alarmes, sonna d’elle-même pour jeter l’effroi parmi les ennemis et pour les éloigner de la vieille métropole, si l’on en croit une tradition du pays sénonais ?
Mais l’histoire, plus grave, rapporte que l’évêque Loup, de bienheureuse mémoire, poursuivi par Clotaire II, et redoutant les bandes farouches du roi de Soissons, se rendit à l’église principale de Sens, et fit sonner la cloche Marie pour appeler le peuple et pour l’exhorter à la prière. Saisis de terreur à ce bruit étrange, les ennemis s’enfuirent, "comme si le Dieu des armées combattait pour les fidèles et pour le pasteur."
Peu de temps après, Clotaire s’empara de la ville de Sens et fit enlever la cloche qui lui avait causé tant d’effroi. Mais transportée dans l’enceinte de Paris, l’harmonieuse Marie « resta muette et ne voulut rendre aucun son. » Frappé de ce prodige, Clotaire la rendit au saint prélat dont les vertus lui avaient été si longtemps inconnues.
Marie recouvra sa voix dès le bourg de Pont-sur-Yonne, et la conserva plus ou moins grave, plus ou moins mélodieuse jusqu’en 1792.
Alexandre ASSIER (1860)

